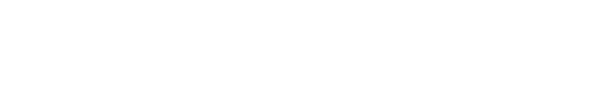LE MONDE SCIENCE ET TECHNO |
Devant cette magnifique unanimité, on est pourtant en droit de s’interroger sur ce qui a conduit à recommander ainsi la minceur pour des raisons sanitaires : quelle est, en la matière, la part de l’effet de mode et celle qui repose sur des bases scientifiques réelles ? Une étude impressionnante, tout juste publiée dans le prestigieux Journal of the American Medical Association, vient bousculer les idées reçues à cet égard.
La corpulence est traditionnellement classée en trois catégories, la normalité, le surpoids et l’obésité, dont les frontières sont définies par l’indice de masse corporelle (IMC, calculé en divisant le poids par le carré de la taille en mètres), sans que l’on sache vraiment ce qui a conduit l’Organisation mondiale de la santé, en 1997, à proposer ces limites. Ainsi, à 81 kg, une personne de 1,80 m est considérée en surpoids, et une autre de 1,64 m comme obèse.
C’est en s’appuyant sur ces catégories de corpulence que Katherine Flegal et ses collègues du Center for Disease Control and Prevention de Washington ont fait la somme de toutes les études publiées dans ce domaine et analysant les liens entre indice de masse corporelle et mortalité dans des populations au départ bien portantes. En tout, une centaine d’études jugées suffisamment rigoureuses ont été retenues, incluant 2,88 millions d’hommes et de femmes dans le monde entier, suivis pendant des durées allant de un à quarante ans. Au terme d’une analyse minutieuse, la conclusion est sans appel : le risque de décès (quelle qu’en soit la cause) est inférieur de 6 % chez les personnes qui sont en surpoids par rapport à celles dont le poids est « normal » (ou « idéal »). L’obésité, elle, est associée à une augmentation de risque de 18 %, mais celle-ci est essentiellement le fait des grandes obésités (IMC de 35 kg/m² ou plus) tandis que l’obésité plus modérée (IMC entre 30 et 35 kg/m²) n’augmente pas le risque par rapport au poids « normal ».
Dans un travail beaucoup plus limité (et non encore publié) portant sur une population de près de 4 000 malades hospitalisés pour un infarctus du myocarde à la fin de l’année 2005 en France métropolitaine, nous retrouvons exactement les mêmes tendances : une fois pris en compte l’âge, la gravité de l’infarctus et les traitements initialement mis en oeuvre, le risque de mourir dans les cinq ans suivant la sortie de l’hôpital n’est pas différent dans toute la plage d’indice de masse corporelle allant de 22 à 35 kg/m², alors qu’il est nettement plus élevé chez les malades les plus maigres (risque accru de plus de 40 %) et au-delà de 35 kg/m² (risque augmenté de 75 %). Le risque est également plus élevé quand, à poids égal, l’obésité se localise au niveau du ventre plutôt qu’au niveau des cuisses et des fesses.
Au vu de ces résultats, il paraît temps de modifier les messages de santé publique dans ce domaine. Ce n’est pas une chose simple, car on sait aussi que, avec l’augmentation constante du poids dans nos sociétés, la proportion de personnes ayant une grande obésité (celle qui est réellement dangereuse pour la santé) a fortement augmenté, et il est donc essentiel d’éviter la dérive qui peut progressivement y conduire. Mais ce n’est pas une raison pour stigmatiser l’embonpoint, qui ne semble finalement pas avoir d’effet véritablement délétère sur la santé tant qu’il ne conduit pas à la grande obésité.
D’autres enjeux, comme la lutte contre le tabagisme ou l’encouragement de l’activité physique régulière, sont autrement plus importants. En termes de poids, les conseils se doivent d’être raisonnables et surtout non culpabilisants : ce ne sont pas quelques kilos en trop qui auront des conséquences néfastes sur la santé. Il y a mieux à faire que de chercher à tout prix à redescendre au-dessous de la barre fatidique du surpoids… Il est d’ailleurs plausible que le plaisir pris à manger chez les bons vivants ait en lui-même des conséquences favorables sur l’organisme, tandis que, à l’inverse, l’anxiété potentiellement générée par certains régimes, où la moindre calorie est comptée, traquée et combattue, a toutes les chances d’avoir des effets néfastes sur la santé.
Tout cela doit nous rappeler à une certaine humilité : en matière de liens entre mode de vie et santé, il est bien difficile d’obtenir des données scientifiques réellement indiscutables sur lesquelles étayer les recommandations, tant les causes de biais et les difficultés méthodologiques sont nombreuses. Prenons l’exemple de la nutrition, corollaire du poids. Evaluer l’effet de ce que nous mangeons ou buvons sur notre système cardiovasculaire et plus généralement sur notre santé est extrêmement délicat. La difficulté commence par la mesure précise de ce que nous mettons dans notre assiette ou dans notre verre. Se souvenir dans le détail de ce qu’on a mangé la semaine dernière est déjà un exercice difficile, dont les résultats sont souvent très approximatifs… Ajoutons à cela le fait que la maladie des artères (l’athérosclérose, responsable des crises cardiaques ou de la plupart des attaques cérébrales et première cause de mortalité dans le monde) met des dizaines d’années à se développer : ce n’est pas ce que nous avons mangé la semaine dernière qui compte, mais ce sont bien nos habitudes alimentaires au cours des vingt ou trente dernières années, et il y a de fortes chances que celles-ci aient beaucoup varié au fil du temps. Sans compter que, même si nous continuons de manger des carottes, comme nous le faisions déjà il y a vingt ans, leur teneur en pesticides et autres conservateurs a pu notablement changer pendant cette période… Bref, la mesure de l’impact de l’alimentation sur notre santé est une affaire très complexe, et il ne faut jamais l’oublier avant de s’aventurer à prodiguer des conseils, par ailleurs trop souvent présentés essentiellement sur le mode répressif de l’interdit.
Finalement, cette belle étude est l’occasion de s’interroger sur le côté totalitaire de certains messages de santé publique, trop souvent moralisateurs ou même franchement castrateurs, alors même qu’ils sont parfois scientifiquement peu fondés. Il est grand temps que les docteurs, en ce domaine, abandonnent le sacro-saint principe de précaution et qu’ils n’interdisent rien de plaisant dont la nocivité ne soit – absolument – avérée !
Nicolas Danchin
(indice de masse corporelle 24,6 kg/m²) est professeur de cardiologie et maladies vasculaires.
Il est également ancien président de la Société française de cardiologie.
Par Nicolas Danchin, professeur de cardiologie et maladies vasculaires